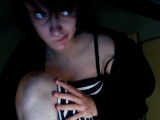« Je ne sais comment en sortir : j'en sortirai pourtant. Je regrette cet atroce Charlestown, l'Univers, la Bibliothè, etc... Je travaille pourtant assez régulièrement, je fais de petites histoires en prose... »
Rimbaud à Ernest Delahaye, Roches, Mai 1873.
Charlestown, ma mie, mon âme, ma foi, ma flamme. Charlestown tu me manques.
Je lisais tout à l'heure quelques vers pris au hasard de MORCEAUX CHOISIS de Victor Hugo, ce livre un peu sale où quelques cahiers ont été oubliés du couteau. Ce livre un peu sale que j'avais volé dans la bibliothèque du lycée, un jour où la surveillante me tournait le dos pour quelques mots fléchés qu'elle était incapable de terminer. Ce livre aux pages jaunies et froissées, couverture arrachée, oublié sur l'étagère nommée « Poésie » que personne n'était tenté de visiter. Une étagère où j'allais me perdre en secret pour caresser les tranches tristes et un peu moisies de quelques livres tirant sur leur fin, que personne n'ouvrait plus depuis des années. Pourquoi celui-ci et pas un autre... aucune idée. Je le trouvais beau, flottant dans ses dentelles de papier arraché, et le jaune de ses pages me rappelait un peu la couleur d'un rond de café qu'imprégnait une table de bar-tabac près du square de la gare.
C'était une époque où je ne savais pas trop sur quel trottoir marcher. J'étais partagé entre les boutons de rose d'une poitrine féminine enfantine, et la violence de quelques garçons secrets pour lesquels j'écrivais des alexandrins vaseux qu'ils ne lisaient jamais. J'oscillais entre robes et pantalons, léchais la vitrine du Chapelier de la place Ducale sous les arcades, rêvais d'un haut de forme un peu trop cher pour ma petite bourse, les casquettes de marin se paraient du bleu magnifique de l'océan, et toujours, je trainais mes souliers sur les chemins boueux du Mont Olympe, les après midi de pluies. Entre mes dents, je serrais comme un mords cette vieille cigarette mentholée qui me tournait la tête à chaque bouffée empoisonnée, et enfonçais mes mains dans mes poches en jurant sur Brian Molko, parce qu'il était très beau, très con, et très libre.
En automne, je parcourais le Cours Briand et remplissais mes poches de marrons piquants pour aller les jeter dans ce bras de Meuse vaseux sous la passerelle qui tendait à s'écrouler tout doucement. C'était beau Charlestown en automne, quand il pleuvait nuit et jour sur les trottoirs souillés de crottes, de mégots et de papiers. Moi j'allais de l'avant. Je rêvais de lointains, d'horizons noirs et carmins qui offraient leur gorge à mes baisers. Je pensais à cette Momo un peu vieillissante qui m'avait oublié dans mon petit Charlestown pour aller s'occuper de ses petits enfants gâtés pourris sous le soleil de Guadeloupe. Je me sentais trahis. C'était moi ton petit fils, ta petite fille, ton petit enfant. Ma grande Momo, je t'en ai tellement voulu quand tu es partie vivre sous les cocos. Du jour au lendemain, c'en était finit de ces grandes aventures que j'inventais dans ton jardin, sous le cerisier, près du compost. Je n'étais plus ce funambule fantastique qui courais sur les bordures de ton potager sans tomber. Ton poste de musique ne chantait plus que du silence. C'en était finit de Bach, Beethoven et Liszt, même ton frigo n'empestait plus de ces fromages que tu oubliais entre deux bouteilles de lait rance. Le poisson rose que tu me faisais manger n'avait plus le même goût, et les gâteaux au yaourt que tu préparais n'étaient plus qu'un vague souvenir enfouit dans mes narines et mes papilles.
Charlestown est un trou. Une abomination présidée par une mairesse imbue d'elle même, un peu bonbon rose, un peu UMP. C'est une ville où il ne fait pas bon se garer sans payer. C'est une ville sale et un peu trop fière d'elle où les vraies valeurs ont été un peu oubliées sous l'argent et le commerce. Rimbaud lui même est devenu objet de foire. On en fait des cartes postales, des posters et des chansons. C'est affligeant.
Tout à l'heure, je lisais quelques vers de Victor Hugo. Ca me rappelait les longues heures de lecture à voix haute pour m'entrainer. Parce que je n'étais pas bon à l'école. Lire et écrire était pour moi d'une difficulté amère pendant le primaire. On se moquait quand je butais, on riait de mes erreurs, de mon orthographe un peu bancale. Alors pour leur prouver que je n'étais pas cette pauvre petite chose qu'on regardait avec dédain, je m'enfermais dans le grenier et au milieu de la poussière et des araignées, je lisais les livres de poésie de mon grand père. Un peu de Baudelaire, de Spleen et d'idéal, de Rimbaud dans Une saison en enfer, de Verlaine et d'automnes nouveaux. Je me perdais dans ces vers qu'à l'époque je ne comprenais qu'à moitié, et au fil du temps je savais lire tout à fait. J'ai finis par enseigner aux vieilles poupées de ma mère, oubliées sous la poussière du grenier, que la poésie d'hommes véritablement heureux est infâme au goûter. Que les vrais poètes croquent dans la mélancolie comme dans une pomme fraîche et encore verte. Que la vie est une tragédie, une pièce de théâtre dans laquelle nous sommes l'acteur principal, mais contrairement aux pièces à succès, aucun public n'applaudit lorsque c'est terminé.
Entre deux pages collées de ces MORCEAUX CHOISIS, j'ai trouvé une carte postale décolorée qui montrait le cours Briand en 1948, la même année où se livre a été édité. Pris de curiosité par ce fabuleux trésor, imaginant quelles mains l'avaient caché dans ce témoignage jaune et débauché, je me pris à rêver des mains un peu artistes d'un lycéen engagé et amoureux de l'art. Faisant de la poésie sa bible, son grand espoir. Un peu blond, un peu sauvage et l'oeil aussi bleu qu'un petit lac de montagne, je le voyais en 1948 parcourir les rue d'un Charlestown libéré. Je m'en vais retranscrire cette double page 208 et 209 qui sentent le vieux, qui sentent bon:
69.
Puisque le juste est dans l'abîme,
Puisqu'on donne le sceptre au crime,
Puisque tous les droits sont trahis,
Puisque les plus fiers restent mornes,
Puisqu'on affiche au coin des bornes
Le déshonneur de mon pays ;
O République de nos pères,
Grand Panthéon plein de lumières,
Dôme d'or dans le libre azur,
Temple des ombres immortelles,
Puisqu'on vient avec des échelles
Coller l'empire sur ton mur ;
Puisque toute âme est affaiblie,
Puisqu'on rampe, puisqu'on oublie
Le vrai, le pur, le grand, le beau,
Les yeux indignés de l'histoire,
L'honneur, la loi, le droit, la gloire,
Et ceux qui sont dans le tombeau ;
Je t'aime, exil! Douleur, je t'aime!
Tristesse, sois mon diadème!
Je t'aime, altière pauvreté!
J'aime ma porte aux vents battue.
J'aime le deuil, grave statue
Qui vient s'asseoir à mon côté.
J'aime le malheur qui m'éprouve,
Et cette ombre où je vous retrouve,
O vous à qui mon coeur sourit,
Dignité, foi, vertu voilée,
Toi, liberté, fière exilée,
Et toi, dévouement, grand proscrit!
J'aime cette île solitaire,
Jersey, que la libre Angleterre
Couvre de son vieux pavillon,
L'eau noire, par moments accrue,
Le navire, errante charrue,
Le flot, mystérieux sillon.
J'aime ta mouette, ô mer profonde,
Qui secoue en perles ton onde
Sur son aile aux fauves couleurs.
...